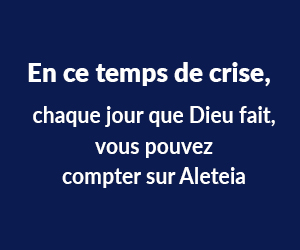Quand ils sont chef d’État, les villes d’eau deviennent les tombeaux des grands militaires : Pétain sombra à Vichy, de Gaulle à Évian. Et depuis lors, nous sommes assommés avec ces histoires blessées dont les plaies suppurent encore. Leur point commun : l’honneur. On ne se remet pas d’une faute morale. Un peuple peut souffrir de la faim, du froid, de la maladie, de l’occupation ; il peut survivre à la disparition de son territoire (comme la Pologne), aux déportations et même à l’extermination. Mais il ne se relève pas d’un mauvais choix fait volontairement par ses dirigeants. Quel homme politique en a conscience ?
Tous les rituels de réparation et autres repentances soulignent l’infamie de la faute morale. C’est comme un secret familial inavouable, source de silences, de haine, même de suicide. Il demeure dans nos mémoires qu’après la bataille de Pavie (1525), François Ier écrivit à Louise de Savoie, sa mère : « Madame, pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune, de toutes choses ne m’est demeuré que l’honneur et la vie qui est sauve. » Son image de monarque séducteur, promoteur des arts et de la langue, estompe le caractère fondamental de cette phrase puissante et magnifique, devenue proverbiale : « Tout est perdu, fors l’honneur. » Ce qui bien sûr veut dire que rien n’est perdu. Si l’honneur est sauf, le corps peut bien rougir ; c’est comme si les meurtrissures de la peau protégeaient la chair du cœur — qui, alors, s’emplit du sang de la fierté, de la pensée droite.
Pourquoi un tel préambule ? Laissons Vichy pour cette fois. Soixante ans après les accords d’Évian, la France vient de voter une loi pour demander « pardon » aux harkis de les avoir abandonnés. Ce texte concrétise le mea culpa présidentiel du 20 septembre. Emmanuel Macron avait alors demandé « pardon » à ces Algériens (citoyens français, rappelons-le) ayant combattu les fellaghas aux côtés de l’armée française. Cette force supplétive compta jusqu’à 200.000 hommes. Le conflit dura huit ans (1954-1962) et fit près de 500.000 morts.
Pardon rime déjà avec déception. Et trop peu rime aussi avec trop tard.
Depuis un décret de 2003, le 25 septembre est reconnu comme journée d’hommage de la Nation aux harkis. Cette date sera inscrite dans la loi. Mais au-delà du symbole, il fallait des actes. Pour cela, le texte crée une Commission nationale de reconnaissance et de réparation. La loi s’intéresse aux « conditions indignes de l’accueil » réservé aux 90.000 harkis et à leurs familles ayant fui l’Algérie après l’indépendance. Cette page méritait d’être écrite d’une encre salvatrice, certes. Car près de la moitié des harkis fut invisibilisée et reléguée dans des camps et des hameaux de forestage. « Ces lieux furent des lieux de bannissement qui ont meurtri, traumatisé et parfois tué », selon les mots de la ministre chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants Geneviève Darrieussecq. Pour ceux-ci, il est prévu une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, de 2.000 à 15.000 euros. 50.000 personnes pourraient en bénéficier pour un coût de 310 millions d’euros sur environ six ans.
Cette mesure de réparation divise les harkis, pour deux raisons : d’abord, le niveau d’indemnisation leur paraît « faible », voire « ridicule », ensuite le dispositif exclut quelque 40.000 rapatriés ayant séjourné dans des « cités urbaines » où, sans être privés de leur liberté de circulation, ils affrontèrent des conditions de vie précaires. Ceux-là n’ont droit à rien. Pardon rime déjà avec déception. Et trop peu rime aussi avec trop tard. Soixante après leur arrivée sur le sol métropolitain, les harkis sont en voie d’extinction. Cet argent, c’était bien avant que ces boat people du Maghreb en avaient besoin, pour se reconstruire.
Un sujet pris en otage
Dans cette histoire, l’usage du mot « abandon » a quelque chose d’ambigu. La loi, comme indiqué plus haut, ne parle que des « conditions indignes de l’accueil ». Mais l’essentiel n’est pas là. L’abandon des harkis se produisit en Algérie. Conformément aux accords d’Évian, l’armée française cessa toutes ses opérations le 19 mars à midi. Au lieu de mettre fin aux hostilités, ce cessez-le-feu inaugura une période de violence extrême. Car l’autre camp viola les accords ou fut incapable de les faire respecter. Le chaos et le massacre des harkis s’ensuivirent.
Cette page sanglante oblige à regarder dans les yeux la statue du commandeur, le général de Gaulle. La France y est-elle prête ? Pas sûr.
Cette page sanglante oblige à regarder dans les yeux la statue du commandeur, le général de Gaulle. La France y est-elle prête ? Pas sûr. Pour le moment, Emmanuel Macron fait du « en même temps » mémoriel, en parlant d’« histoire complexe » et de « mémoire composite ». Sauf que soixante après, l’histoire ne passe toujours pas, et la guerre d’Algérie, aux dires de certains, n’est pas finie. Il sera impossible de tourner la page tant que le sujet sera pris en otage. « Une certaine gauche voit encore les pieds-noirs comme des exploiteurs et les soldats comme des tortionnaires », observe le journaliste du Figaro Jean Sévillia, les harkis étant renvoyés à un statut de collabos. Cette position rejoint celle de la junte. Nourrie par la rente mémorielle, sa propagande élève des générations d’Algériens dans le même esprit et permet au régime d’influencer les millions de binationaux vivant en métropole, afin qu’ils ne deviennent pas français.
Les choses bougent
Néanmoins, les choses bougent un peu. Dans un discours à l’Élysée fin janvier, le chef de l’État a jugé « impardonnable pour la République » la fusillade de la rue d’Isly à Alger le 26 mars 1962, quand l’armée tua des dizaines de partisans de l’Algérie française. Emmanuel Macron a aussi estimé que le « massacre du 5 juillet 1962 » à Oran devait être « reconnu ». Parallèlement, il a rendu hommage aux neuf victimes mortes au métro Charonne, à Paris le 8 février 1962, lors d’une manifestation pour la paix en Algérie réprimée par la police du préfet Maurice Papon.
Si ce travail mémoriel fait son chemin, les harkis attendent toujours. On verra si la commémoration des Accords d’Évian le 19 mars, soit vingt jours avant le premier tour de la présidentielle, prévoit un pas supplémentaire sur le chemin de leurs souffrances enfouies.